L’histoire des semi-conducteurs [2/3]: Une histoire de géopolitique
Dans ce deuxième article (d’une série de trois) basé sur le livre « La guerre des semi-conducteurs » de Chris Miller, Finance-Aces retrace pour vous les enjeux géopolitiques autour de l’industrie des semi-conducteurs au XXe siècle.
CULTURE
Matthieu D.
1/29/20257 min read
Dans ce deuxième article (d’une série de trois) basé sur le livre « La guerre des semi-conducteurs » de Chris Miller, Finance-Aces retrace pour vous les enjeux géopolitiques autour de l’industrie des semi-conducteurs au XXe siècle. Cet article illustre l’influence géopolitique des semi-conducteurs lors de la guerre froide et leurs rôles dans l’émergence des économies d’Asie de l’Est.
Cet article est le moins « économico-boursier » de la série, mais il donne des éléments de compréhension intéressants d’un point de vue historique, utile pour la compréhension du troisième article sur les tensions géopolitiques actuelles avec la Chine.
Pour ceux qui n’auraient pas encore lu le premier article et voudraient comprendre les développements technologiques dans l’industrie des puces, je vous renvoie vers cette page.


La guerre froide technologique
À partir des années 1960, l’Union soviétique tenta de copier les technologies américaines, mais échoua à établir une industrie compétitive. Les Soviétiques ne cherchèrent qu’à reproduire, dans le secret, des puces déjà existantes, avec une structure administrative rigide, sans innover, et exclusivement pour des applications militaires.
Au milieu des années 1960, les États-Unis étaient empêtrés dans la guerre du Vietnam. Malgré leur supériorité technologique et militaire apparente, ils se montrèrent inefficaces dans ce contexte de guérilla. Ils ne parvinrent pas à atteindre les cibles avec précision. À cette époque, plus de 800 bombes et roquettes furent larguées sur le pont stratégique de Thanh Hoa, long de 165 mètres, sans réussir à le détruire. Le problème résidait dans le fait que les premiers missiles guidés utilisaient des tubes à vide, lesquels dysfonctionnaient dans les conditions militaires difficiles (décollage, atterrissage, et secousses en vol).
Vers la fin de la guerre, la tâche de conception un missile guidé fut confiée à Texas Instruments (TI). En seulement neuf mois, ils développèrent une bombe guidée équipée d’une puce, qui détruisit le pont du premier coup. Mais il était trop tard : la guerre avait trop duré, le conflit était déjà perdu, et les États-Unis en ressortirent affaiblis.
À cette époque, de nombreux observateurs jugèrent que l’URSS avait égalé, voire dépassé, la puissance militaire américaine, notamment en termes de nombre de chars et d’avions. Cependant, William Perry, stratège militaire au Pentagone, comprit que rivaliser avec l’URSS sur le plan quantitatif n’était pas une stratégie viable. Il proposa alors une nouvelle approche : la stratégie de compensation.
Le cœur de cette stratégie consistait à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Perry préconisa de concentrer les efforts sur le progrès technique afin de développer des armes capables de changer le cours des guerres et de donner un avantage décisif aux États-Unis. Cela impliquait l’amélioration des systèmes de traitement de l’information, le développement d’armes guidées de haute précision, et l’automatisation des conflits.
Au début des années 1980, cette stratégie commença à porter ses fruits. Les armes américaines devinrent bien plus efficaces, notamment grâce à leur précision. L’enjeu de la précision et des systèmes de détection et de défense résidait dans la capacité à neutraliser l’arsenal nucléaire adverse. Selon certaines estimations soviétiques, si les États-Unis avaient lancé une première frappe nucléaire, ils auraient pu désactiver jusqu’à 98 % des ICBM soviétiques.
La guerre du Golfe : une démonstration de force
Alors que les conflits précédents du XXe siècle, en particulier la Seconde Guerre mondiale, reposaient sur des enjeux industriels – la puissance de feu dépendant largement de la production d’acier et de charbon –, la guerre du Golfe en 1991 marqua un changement de paradigme. Ce conflit illustra l’importance des semi-conducteurs dans la supériorité militaire américaine.
Grâce aux missiles guidés et aux systèmes de détection, rendus possibles par les puces électroniques, les États-Unis purent mener des frappes précises, inaugurant une nouvelle ère dans la conduite des guerres. Cette précision révolutionna les tactiques militaires, contrastant fortement avec les bombardements massifs et peu ciblés des décennies précédentes. Avant de s’effondrer, l’Union soviétique ne put que constater la supériorité militaire technologique des États-Unis.
Le développement de l’industrie : au-delà de l’Amérique
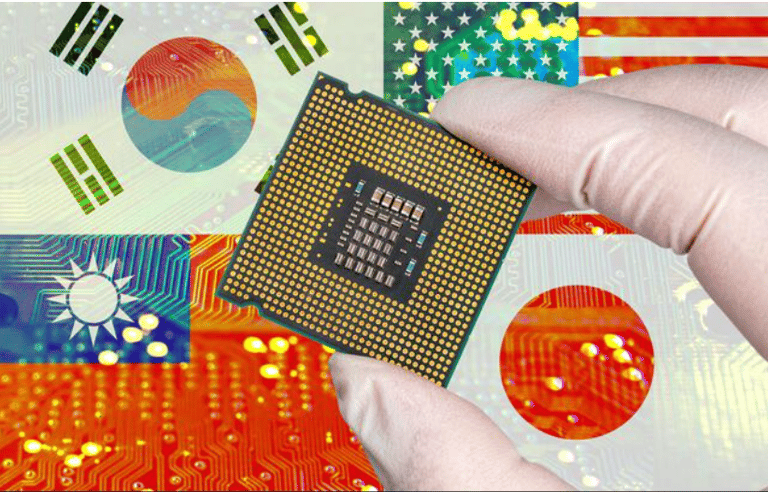
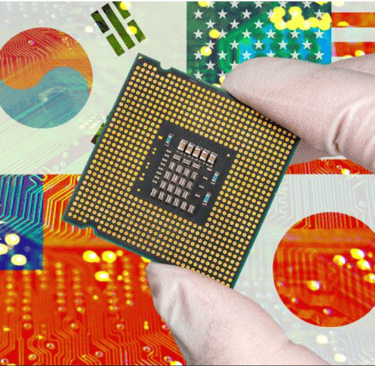
Les débuts de la mondialisation
Pendant la Guerre froide, afin de lutter contre l’influence croissante du communisme en Asie, les États-Unis décidèrent d’intégrer le Japon à leur système d’échanges commerciaux. Ils soutinrent la reconstruction économique du pays sur un modèle capitaliste. Cette opportunité fut saisie par des entrepreneurs japonais visionnaires tels qu’Akio Morita, fondateur de Sony. En développant des applications et des produits innovants, comme des radios portables et le Walkman, ils élargirent les marchés pour les semi-conducteurs.
Ce soutien permit au Japon, ravagé après la guerre et autrefois réputé pour produire des articles de faible qualité à bas coût, de devenir dès les années 1960 un acteur majeur de l’industrie des semi-conducteurs. Le pays se spécialisa dans la production de puces fiables, à grande échelle et à des coûts compétitifs, surpassant même les Américains dans certains domaines.
Toujours dans une double optique – contenir les influences communistes pour le gouvernement américain, et accroître la productivité pour les entreprises –, cette « colonisation industrielle » s’étendit à d’autres pays d’Asie du Sud-Est. Fairchild fut la première à délocaliser une usine à Hong Kong, suivie de Singapour, Taïwan, et d’autres nations non-communistes. Cette stratégie s’avéra payante. Les entreprises profitèrent d’une main-d’œuvre peu coûteuse mais qualitative, tandis que les usines de semi-conducteurs offraient des salaires élevés par rapport au niveau de vie moyen de ces pays. Cela détourna de nombreux ouvriers de l’idéologie communiste, tout en favorisant le développement économique de ces nations. Ainsi, l’expansion industrielle des semi-conducteurs en Asie du Sud-Est permit à ces régions de devenir des piliers essentiels de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
La montée en puissance asiatique
Le Japon : le pays du capital levant
Dans les années 1980, le Japon devint un concurrent redoutable grâce à des entreprises comme Sony et Toshiba. Spécialisé dans les puces mémoire et l’électronique grand public, le Japon domina une partie du marché en produisant des semi-conducteurs de qualité à des prix cassés.
Les entreprises japonaises furent accusées de concurrence déloyale par les sociétés américaines, car elles profitaient d’un coût du capital bien plus faible grâce aux subventions généreuses du gouvernement nippon. Elles étaient également soupçonnées d'espionnage industriel. Pour se défendre, les fabricants de semi-conducteurs américains, tels que Jerry Sanders d’AMD, Andrew Grove et Robert Noyce d’Intel, fondèrent l’Association de l’Industrie des Semi-conducteurs (Semiconductor Industry Association). Ce lobby contacta le gouvernement américain et le Pentagone pour alerter sur les risques de dépendance envers l’industrie étrangère, en particulier japonaise. Ils arguèrent que la sécurité nationale des États-Unis pourrait être compromise si les semi-conducteurs devenaient majoritairement importés.
Ces efforts aboutirent à des baisses d’impôts et à des changements réglementaires favorisant les acteurs américains.
À la fin des années 1980, le Japon était devenu la deuxième puissance économique mondiale. Un nationalisme renouvelé se développa alors dans le pays pour affirmer sa supériorité face aux États-Unis. Les ambitions japonaises ne manquaient pas, notamment celle de supplanter la puissance géopolitique et économique américaine.
La montée de la Corée du Sud et le déclin du Japon
Pour contrer le Japon, les Américains mirent en œuvre une stratégie inspirée des pratiques nippones : le dumping. Ils poussèrent l’industrie des semi-conducteurs en Corée du Sud, alors un pays en voie de développement. Cela permit à des entreprises sud-coréennes, comme Samsung – initialement spécialisée dans le commerce de poissons et de légumes –, de se réorienter vers les semi-conducteurs, avec le soutien actif du gouvernement local.
En 1990, la crise frappa durement le Japon, provoquant l’effondrement de ses marchés financiers. Ce fut le début d’une longue récession pour le pays, dont la domination économique reposait sur un surinvestissement public et des entreprises qui finançaient l’innovation et leur expansion sans prendre en compte la rentabilité. Cette crise marqua le début du déclin de la suprématie japonaise dans l’industrie des semi-conducteurs, au profit d’autres acteurs asiatiques comme la Corée du Sud.
TSMC : La clé de Taïwan
Le gouvernement de Taïwan comprit rapidement que le développement de l’industrie des semi-conducteurs et les transferts de savoir technologique américain vers l’île pouvaient créer un intérêt stratégique pour les États-Unis, garantissant ainsi leur soutien et leur protection.
Le ministre taïwanais de l’Économie sollicita Morris Chang, ingénieur ayant joué un rôle clé dans le développement de la production en Asie chez Texas Instruments. À la demande du gouvernement, Chang fonda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en 1987, avec un soutien financier et légal significatif. Il introduisit également un modèle d’affaires révolutionnaire : créer une entreprise de semi-conducteurs se consacrant exclusivement à la fabrication des puces conçues par ses clients. Ce concept novateur permit l’émergence des entreprises fabless, qui se concentrèrent uniquement sur la conception, en externalisant la production. TSMC devint ainsi la première fonderie au monde et Taïwan devint un acteur central dans l’industrie des semi-conducteurs.
Au début des années 2000, la miniaturisation des transistors atteignit un point critique : leur taille réduite provoqua des effets quantiques, notamment l’effet tunnel, qui altéraient la qualité des traitements et causaient des erreurs. Pour surmonter ce défi, il fallut des efforts d’innovation considérables, menant à la transition des transistors 2D vers des transistors 3D, connus sous le nom de FinFET.
A la même période, le marché devint plus compétitif avec la création de GlobalFoundries en 2009, issue de la scission du groupe AMD. Cette nouvelle fonderie indépendante, bien positionnée pour produire des transistors en 3D, menaça la suprématie de TSMC. Malgré ces défis, Morris Chang fit des paris audacieux. Il identifia très tôt le potentiel des smartphones et, en dépit des difficultés financières liées à la crise économique mondiale, investit massivement dans l’amélioration des processus de production.
Chang développa également des alliances stratégiques avec des concepteurs de puces pour imposer les standards de TSMC dans l’industrie. Ces initiatives s’avérèrent payantes et consolidèrent la position de TSMC en tant que leader mondial.
Aujourd’hui, l’île produit une grande partie des puces les plus avancées au monde, renforçant son importance stratégique. Cette position dominante a complexifié les relations entre les États-Unis, la Chine et Taïwan, dans un contexte où la dépendance mondiale à cette technologie critique continue de croître…
Finance Aces
La connaissance enrichissante.
COntact
Newsletter
contact@finance-aces.com
© 2024. All rights reserved.
