L’histoire des semi-conducteurs [Partie 3/3]: l’ombre chinoise
Cet article basé sur le livre « La guerre des semi-conducteurs » de Chris Miller, Finance-Aces retrace pour vous l’histoire chinoise des semi-conducteurs et les enjeux géopolitiques entre Pékin, Washington et Taipei.
CULTURE
Matthieu D.
2/6/20259 min read
La Chine : un retardataire qui court vite
Dans ce troisième (et dernier) article basé sur le livre « La guerre des semi-conducteurs » de Chris Miller, Finance-Aces retrace pour vous l’histoire chinoise des semi-conducteurs et les enjeux géopolitiques entre Pékin, Washington et Taipei.
Cet article donne des éléments de compréhension autour de l’industrie des semi-conducteurs et des risques liés à un conflit commercial ou militaire impliquant la Chine. Ce sont des risques à avoir en tête pour tous les investisseurs, surtout les fans de tech !
Je vous renvoie vers le premier article ou le deuxième article pour ceux qui ne les auraient pas encore lus et voudraient comprendre les développements technologiques dans l’industrie des puces et l’impact géopolitique qu’ils ont eu au XXe siècle.
Un développement entravé sous Mao
Sous Mao Zedong, le développement des semi-conducteurs en Chine fut entravé par des choix politiques et économiques. La Révolution culturelle affaiblit le système éducatif et envoya des scientifiques dans des camps de travail, réduisant drastiquement les capacités de recherche et d'innovation. De plus, l'idéologie prolétarienne réprouvait les élites scientifiques, rendant impossible tout développement industriel significatif. Plus étonnant encore, Mao suggéra que chaque prolétaire produise des puces, une idée totalement irréaliste qui freina davantage les progrès technologiques du pays.
Avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping dans les années 1980, la Chine entama des réformes visant à moderniser son économie. La science et la technologie furent replacées au centre des priorités nationales. Toutefois, le pays accusait un retard important par rapport aux économies avancées, et ses industries étaient freinées par une bureaucratie lourde qui mis des bâtons dans les roues de l'innovation.
L’essor des champions nationaux
Dans les années 1990 et 2000, la Chine posa les bases d'une industrie des semi-conducteurs. L'un des moments clés fut la création de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) par Richard Chang, un ingénieur formé aux États-Unis. Soutenue par des fonds étrangers et par le gouvernement chinois, SMIC ambitionnait d'imiter le modèle à succès de TSMC à Taïwan, en attirant des experts internationaux pour combler les lacunes technologiques du pays.
Parallèlement, des entreprises comme Huawei, fondée par Ren Zhengfei à la fin des années 1980, jouèrent un rôle crucial dans le développement des technologies connexes. Initialement axée sur le commerce de matériaux électroniques, Huawei étendit ses activités à la conception de puces et aux infrastructures télécoms, renforçant ainsi la compétitivité chinoise dans ce domaine stratégique.
Les stratégies de transferts technologiques
La Chine misa largement sur des transferts de technologie pour rattraper son retard. Grâce à des joint-ventures et des partenariats avec des entreprises étrangères, telles qu’IBM et AMD, le pays accéda à des connaissances précieuses. Ces collaborations, souvent motivées par l'accès au vaste marché chinois, permirent d'accélérer la courbe d'apprentissage des entreprises locales.
Cependant, ces stratégies ne furent pas toujours couronnées de succès. Les tentatives de copier les modèles occidentaux ou taïwanais furent parfois entravées par des problèmes de qualité ou une mauvaise gestion des projets. Par exemple, HSMC, une initiative ambitieuse visant à rivaliser avec TSMC, échoua finalement faute de compétences techniques et de leadership efficace.
Le défi de l’innovation locale
Malgré ces obstacles, la Chine commença à investir massivement dans la recherche et le développement. Des entreprises comme SMIC réalisèrent des avancées significatives, bien que toujours limitées par le monopole de certaines technologies critiques, notamment dans la lithographie ultraviolette extrême (EUV), un domaine dominé par la société néerlandaise ASML.
Huawei joua également un rôle moteur en investissant dans la conception de puces pour répondre aux besoins des infrastructures 5G et de l'intelligence artificielle.
Le défi chinois : entre ambition et réalité
Made in China : une stratégie délibérée
Le gouvernement chinois identifia très tôt sa dépendance aux semi-conducteurs étrangers comme une menace majeure pour sa sécurité nationale et son indépendance économique. Sous la direction de Xi Jinping, des plans stratégiques furent mis en place pour stimuler l'industrie locale et faire de la Chine un leader mondial dans les hautes technologies, y compris les semi-conducteurs.
Les transferts de technologie et les fusions stratégiques
Pour combler ce retard, la Chine a adopté une stratégie proactive de transferts technologiques, souvent à travers des joint-ventures ou des acquisitions d'entreprises étrangères. Zhao Weiguo, un milliardaire autodidacte à la tête du fonds d'investissement Beijing Jiankun, réalisa de nombreuses fusions et acquisitions pour renforcer la présence chinoise dans l’industrie des semi-conducteurs. Il finança également des partenariats avec des sociétés américaines telles qu’Intel et XMC.
Cependant, ces efforts se heurtèrent rapidement aux restrictions imposées par les gouvernements étrangers. Des initiatives chinoises visant à acquérir des entreprises stratégiques comme TSMC ou Micron furent bloquées par les autorités américaines et taïwanaises, illustrant les limites de cette approche.
Lancer l’assaut : une ambition freinée par les réalités technologiques
En combinant un discours de libéralisation économique avec une approche martiale, Xi Jinping a appelé à un développement rapide de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Toutefois, malgré ces efforts, la Chine ne représente encore qu'une faible part du marché mondial, avec moins de 10 % des activités liées aux semi-conducteurs, telles que la propriété intellectuelle ou la conception avancée.
L’industrie chinoise souffre notamment d’un retard technologique sur des équipements clés, comme la lithographie ultraviolette extrême (EUV), essentielle à la fabrication des puces les plus avancées. Plus largement, le pays reste fortement dépendant de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour plusieurs composants critiques, notamment l’architecture des processeurs pour ordinateurs et serveurs.
Huawei et la 5G : un symbole de l’ambition chinoise
Huawei incarne l’ambition technologique chinoise. Sous la direction de son fondateur Ren Zhengfei, l’entreprise est devenue un leader mondial des infrastructures télécoms et un acteur clé dans le développement de la 5G. Cette technologie permet une transmission de données ultra-rapide et ouvre la voie à une connectivité étendue pour l’Internet des objets.
Huawei a appliqué des stratégies similaires à celles de Samsung et Sony :
Cultiver des relations politiques pour obtenir une réglementation favorable et des financements ;
Identifier les produits pionniers sur le marché et apprendre à les fabriquer avec une qualité équivalente, mais à moindre coût ;
Se mondialiser rapidement en s’exposant aux marchés étrangers.
Cependant, Huawei ne s’est pas contentée de suivre ces modèles : l’entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement, avec un budget comparable à celui des géants de la Silicon Valley.
La montée des tensions entre les États-Unis et la Chine
Un tournant géopolitique : de la coopération à l’affrontement
Au milieu des années 2010, l’industrie américaine des semi-conducteurs commença à s’inquiéter de la montée en puissance chinoise. La Chine, qui avait longtemps été perçue comme un simple suiveur technologique, gagnait rapidement du terrain, portée par des investissements massifs et une stratégie agressive de transferts de technologies. Pour les États-Unis, qui avaient prôné la mondialisation et la libre concurrence sous le principe du "run faster" (courir plus vite), cette progression représentait une menace. L’administration américaine réalisa progressivement que la Chine n’était plus un simple marché émergent, mais un concurrent direct dans une industrie clé pour la sécurité nationale et la suprématie technologique. Le cas de Huawei est emblématique. La société a attiré l'attention des États-Unis, qui l'accusent de représenter une menace pour la sécurité nationale. D’autres pays suspectent également la firme chinoise d’espionnage, comme l’Australie qui lui a interdit l’accès à son marché.
À Washington, les débats sur la question des semi-conducteurs prirent de l’ampleur. Les positions divergeaient au sein du gouvernement et des milieux économiques. Certains responsables politiques voyaient la situation sous un prisme purement commercial, à l’image de Donald Trump, qui dénonçait une concurrence déloyale et militait pour un rééquilibrage des échanges. D’autres, perçurent un risque stratégique majeur : si la Chine devenait capable de produire ses propres puces avancées, elle pourrait s’affranchir des technologies américaines et mettre en péril l’hégémonie des États-Unis dans de nombreux domaines, y compris la défense.
Face à ces préoccupations, une nouvelle faction influente apparut au sein de l’administration américaine : les "China Hawks", ou faucons chinois. Ces analystes et stratèges considèrent que la politique industrielle chinoise constitue une menace existentielle pour les intérêts américains et préconisent des mesures radicales pour limiter son développement.
En effet, la Chine rattrape progressivement son retard pour la puissance de calcul et les semi-conducteurs. Ainsi les Etats-Unis sont en train de perdre leur suprématie militaire qui repose sur la technologie…
Et si la Chine était en train de réussir ce sur quoi l’URSS avait échoué ?
Les Etats-Unis cherchent une nouvelle façon de prendre de l’avance sur le plan militaire en développant d'autres technologies. L'attention semble se porter sur les technologies de brouillage des signaux et des ondes pour déstabiliser les capteurs existants et sur des nouvelles façons de communiquer pour surmonter les brouilleurs.
Vers une guerre commerciale : les sanctions contre Huawei et ZTE
L’une des premières réponses des États-Unis fut de s’attaquer directement aux champions chinois des télécommunications, Huawei et ZTE. Ces entreprises, leaders dans le déploiement des réseaux mobiles et de la 5G, dépendaient largement de la technologie américaine pour leurs équipements. Washington imposa progressivement des restrictions, empêchant ces sociétés d’accéder aux composants et logiciels critiques, notamment les puces de pointe fabriquées par des entreprises américaines comme Qualcomm et Nvidia.
Un paradoxe majeur émerge cependant, très bien résumé par un fonctionnaire de la maison blanche : "Notre problème fondamental est que notre concurrent numéro 1 est notre client numéro 1." En d’autres termes, la Chine, bien qu’en rivalité avec les États-Unis, reste aussi son principal client en matière de semi-conducteurs. Cette interdépendance économique complique la mise en place de mesures protectionnistes et illustre la complexité de la guerre technologique en cours.
Taïwan : un champ de bataille au cœur de la guerre des semi-conducteurs
L’obsession chinoise pour Taïwan : une menace grandissante
Depuis plusieurs décennies, la Chine considère la réunification avec Taïwan comme un objectif stratégique majeur. Sous la présidence de Xi Jinping, cette ambition s’est renforcée. C’est l'objectif principal du gouvernement chinois actuel. Cependant, la situation est plus complexe qu’une simple revendication territoriale : Taïwan est un acteur central dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, notamment grâce à TSMC.
Toute intervention militaire chinoise contre Taïwan poserait donc un dilemme crucial. D’un côté, la conquête de l’île permettrait à Pékin de contrôler une industrie vitale et de réduire sa dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés. De l’autre, une invasion risquerait de provoquer des destructions catastrophiques, mettant en péril la production mondiale de semi-conducteurs et nuisant gravement à l’économie chinoise elle-même.
Scénarios d’intervention militaire : invasion, blocus ou stratégie progressive ?
Dans le 54eme et ultime chapitre de « La guerre des semi-conducteurs », Chris Miller évoque les principaux scénarios envisagés si la Chine décidait d’intervenir militairement à Taïwan :
Une attaque directe sur l’île principale
Ce scénario est le plus risqué pour la Chine, car il nécessiterait une invasion amphibie massive, exposant ses forces à une résistance taïwanaise soutenue par des alliés potentiels comme les États-Unis et le Japon. C’est aussi le plus improbable selon Chris Miller.
Un assaut sur des îles secondaires
Plutôt qu’un assaut frontal sur l’île principale, la Chine pourrait choisir de s’emparer d’îles stratégiques plus petites, comme l’île de Pratas, afin de tester la réaction des États-Unis et de leurs alliés tout en mettant progressivement Taïwan sous pression.
Un blocus partiel ou total de Taïwan
En coupant les approvisionnements et les exportations maritimes et aériens, la Chine pourrait asphyxier progressivement l’économie taïwanaise sans recourir à une invasion directe. Un blocus permettrait également à Pékin d’imposer un rapport de force et de pousser Taïwan à la négociation sous la contrainte.
Les enjeux : les usines ?
L’un des enjeux majeurs d’une intervention chinoise réside dans le sort de TSMC et de l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs.
Si les usines de TSMC venaient à être détruites, ce serait une catastrophe économique mondiale, car elle entraînerait une chute brutale de 37 % de la production mondiale de puissance de calcul dès l’année suivante. Cela provoquerait une crise bien plus grave que la pénurie post-covid, affectant non seulement les smartphones et les serveurs, les réseaux de télécommunications, mais aussi toute l’industrie (électroménager, automobile ...).
Paradoxalement, cette option nuirait autant, voire plus, à la Chine qu’aux pays occidentaux, car Pékin dépend encore fortement des semi-conducteurs taïwanais pour ses propres industries. Pendant que les États-Unis pourraient encore s’appuyer sur des alternatives comme Samsung et Intel, la Chine verrait alors son accès aux puces les plus avancées s’effondrer brutalement.
S’emparer des infrastructures intactes, cette solution est théoriquement plus avantageuse pour la Chine, mais en pratique, elle soulève plusieurs défis. Une usine de semi-conducteurs ne peut pas fonctionner sans son écosystème de partenaires internationaux. Les équipements de lithographie EUV d’ASML, par exemple, nécessitent une maintenance régulière par des experts étrangers. Sans le soutien de ces entreprises occidentales, même une TSMC sous contrôle chinois pourrait rapidement devenir inopérante.
Par ailleurs, l’auteur fait un parallèle avec l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, qui a démontré qu’une guerre de reconquête, jugée improbable, pouvait bel et bien se produire au XXIe siècle.
L’enjeu taïwanais dépasse largement la seule question territoriale. Il s’agit d’un véritable pivot de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Une confrontation militaire, même limitée, bouleverserait l’équilibre mondial des semi-conducteurs et provoquerait une crise économique planétaire.
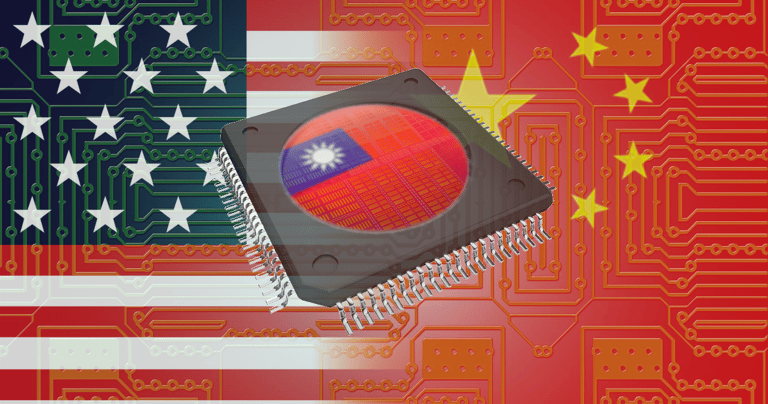
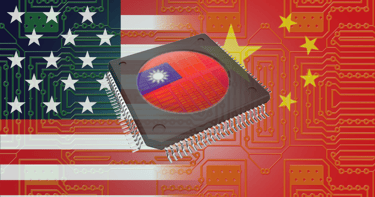
Finance Aces
La connaissance enrichissante.
COntact
Newsletter
contact@finance-aces.com
© 2024. All rights reserved.
